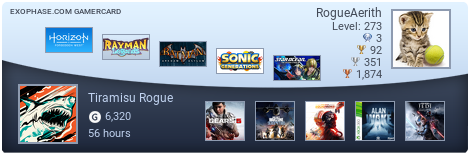Human-error processor (Ghost in the Shell 1.5) relate des histoires courtes relatives à des enquêtes menées par la Section 9.
Deux films d'animation sont sortis en 1994 et 2004, réalisés par Mamoru Oshii (qui travaillera sur Jin-Roh après son succès sur Ghost in the Shell).
Un anime est né, appelé Stand Alone Complex, séparé en deux saisons distinctes. La première saison, dénommée simplement Stand Alone Complex, a vu Mamoru Oshii (scénariste des films), remplir le rôle de superviseur et co-scénariste, cette première saison subissant donc son influence. La seconde saison, appelée Stand Alone Complex 2nd GIG, est davantage marquée par la patte de Kenji Kamiyama, connu pour avoir été directeur de l'animation sur Jin-Roh (en collaboration avec Oshii) et scénariste sur Blood the Last Vampire.
Kenji Kamiyama a condensé/monté les 26 épisodes de la première saison de l'anime, et a rajouté quelques scènes inédites, dans un premier OAV : Stand Alone Complex - The Laughing Man. Il a effectué la même opération avec les 26 épisodes de la seconde saison avec l'OAV Stand Alone Complex - Individual Eleven.
Un troisième OAV, Ghost in the Shell: S.A.C. Solid State Society, est récemment sorti. Il ne reprend aucune des deux saisons mais est une véritable suite à l'anime. On attend un retour de la série.
Si la chronologie de la série et ses différentes déclinaisons peut paraître complexe, Ghost in the Shell n'en demeure pas moins passionnant.
On va d'abord s'intéresser aux films étant donnés leur impact dans le monde de l'animation.
Quand bien même ne connaît-on rien du manga comme de l'anime, les deux films peuvent être regardés avec délectation et l'on ne perd rien du tout, on y gagne même puisque la découverte n'en est que plus savoureuse (Innocence demandant quand même une connaissance du premier...).
Ghost in the Shell : L'âme enfermée dans une carcasse
Le renouveau du cinéma d'animation pour un cyber-punk à son plus haut niveau
En 1991, trois ans après le Japon, l'Europe découvre Akira, un film d'animation post-apocalyptique violent, haletant, doté d'une mise en scène d'une puissance rare. L'Occident découvre un cinéma d'animation japonais encore méconnu jusqu'à présent, un cinéma mature où l'on perçoit un talent phénoménal pour un genre particulier : le cyberpunk. Le cyberpunk : des personnages désabusés, des univers futuristes où la technologie a pris le pas sur l'Homme, un monde pollué, une criminalité qui explose, des organismes qui tentent de contrôler les masses, des complots visant à mener à la fin du Monde, un design où le noir et le gris interdisent le vert ou le bleu ciel...
L'Occident prend conscience de deux choses : les Etats-Unis ne sont pas les seuls maîtres de la science-fiction et l'univers du manga n'est pas aussi niais qu'on le dit...
Akira est un véritable choc, un éveil, une réalité : le Japon semble avoir les moyens de s'imposer dans le monde de l'animation après avoir connu son heure de gloire dans le cinéma traditionnel avec ses chefs d'oeuvre oniriques (le trio Kurosawa-Oshima-Imamura) dans les années 70-80 !
Après la vague Akira, et dans un autre genre un Hayao Miyazaki qui émerge mais qui demeure encore peu connu en Occident, Ghost in the Shell débarque en 1994. Second choc. Une leçon de cinéma.
J'exagère ? Pas le moins du monde. Voici pourquoi...
Scénario
Années 2030, Japon. Les frontières entre l'Homme et la machine sont abolies. Le major Motoko Kusanagi, cyborg féminin, est membre de la section 9, une unité anticriminelle d'élite. La section 9 est chargée de traquer un hacker connu sous le nom de Puppet Master (le Marionnettiste), qui serait peut-être un projet d'une autre section qui aurait mal tourné... Le Puppet Master peut prendre le contrôle de l'esprit de tout humain ou cyborg par l'intermédiaire du Réseau numérique mondial (l'internet des années 2030). La section 9 finit par découvrir que le Puppet Master n'est pas une personne physique mais une IA qui a développé, pour la première fois, une conscience. Ceci remet en cause une des spécificités, déjà bafouées, de l'être humain : la conscience de soi. Le Puppet Master ne souhaite pas se multiplier tel un virus mais créer une nouvelle forme de vie unique en fusionnant des ghosts (=âme/esprit). Kusanagi, qui doute de son identité, semble être le sujet tout désigné en vue de créer ce nouvel être.
Dans l'univers de Ghost in the Shell, on distingue trois types d'êtres. Les Humains non-améliorés sont devenus très peu nombreux. Les androïdes sont des machines à part entière, humaines seulement en apparence. Enfin, le cyborg (comme le major Kusanagi) est une créature issue de la fusion entre la machine et l'organique. Il possède encore son cerveau, enfermé dans une boîte crânienne en métal, tout ceci dans un corps artificiel ou circuits électroniques côtoient vaisseaux sanguins et organes. On comprend le questionnement de Kusanagi sur son identité... Quel degré d'humanité subsiste ?
Une animation ultra-dynamique
Pour l'époque (début des années 90), Ghost in the Shell est une prouesse technique. Jamais de 2D n'a été rendue aussi époustouflante. Ghost in the Shell mélange un scénario atypique à des scènes d'action tendues. Dans ce monde, les nouvelles technologies sont dominantes. Par conséquent, Oshii et son équipe n'ont pas eu le choix : il fallait créer un univers où tous les objets sont robotisés ou futuristes. Voici donc dans Ghost in the Shell le classique camouflage thermo-optique, un Réseau numérique mondial (internet) incorporé dans le ghost (esprit) du cyborg, des armes en pagaille et les balles High-speed ^^ En matière d'action, on est servi : les gunfights sont époustouflants et ont bien vieilli !
Un trip métaphysique... De la philosophie au sens noble
Se concentrant sur la psychologie du major Kusanagi, Ghost in the Shell soulève une problématique récurrente : dans une société ultra-robotisée où les frontières entre Hommes et machines sont écartées, qu'est-ce finalement qu'un être humain ? A partir de là, les questions sous-jacentes sont légions. Ce film regorge de scènes cultes. Outre les scènes de combats révolutionnaires à l'époque, une scène dans les fonds marins et une scène de promenade dans les canaux de Neo-Tokyo sont deux métaphores des interrogations du major Kusanagi.
Devant tant de richesse, les interprétations sont multiples.
Quid du titre ? L'esprit dans une carcasse ? Cela renvoie tout simplement à une entité non-humaine qui posséderait une âme, le thème du film. Il est d'ailleurs assez ironique de constater qu'un film traitant d'un esprit enchâssé dans une chose nous donne autant de possibilités pour réfléchir sur notre sort.
Dans Ghost in the Shell pour ma part, j'ai pu percevoir que le but du Puppet Master est de montrer aux Hommes qu'une entité immatérielle comme une simple IA (qui n'est même pas une vraie machine donc) peut acquérir des spécificités humaines (parlons plutôt d'ex-spécificités quand on voit ce que l'Homme devient dans Ghost in the Shell...). J'ai ainsi fait le parallèle avec ce que les Humains font dans le film (2030), c'est-à-dire qu'ils acquièrent des compétences autrefois réservées à la machine, ou ce qu'ils font dans la réalité aujourd'hui, c'est-à-dire leur obsession des nano-technologies et du progrès technique, vus comme seules possibles garanties du bonheur futur d'un Homme amélioré. Si les Hommes acquièrent des techniques liées à la machine, pourquoi empêcher ce qui se passe dans ce film, soit l'acquisition d'une humanité par une machine ou toute autre entité ? Les perceptions divergent face à un tel chef d'oeuvre, ce qui le rend d'autant plus passionnant mais toujours compréhensible.
Ambiance dantesque
Ah... L'opening de Ghost in the Shell et ses choeurs... Certains tombent à terre sous le poids de l'émotion, d'autres ne peuvent supporter des voix si aiguës. En tous les cas, Ghost in the Shell pullule de scènes d'anthologie et l'intro est de celles-là : la création du major Kusanagi (son passage de l'état humain à un état plus robotisé). Le doublage japonais est de rigueur même si la version française s'en tire étonnamment bien ! (le doublage de Batô n'est autre que la voix de brute de ce bon vieux Terminator). La musique du combat final (un cyborg contre un tank, comment louper ceci !) est grave, préoccupante : ce qui en fait un combat redoutable ! Le film n'est en aucun cas prévisible. Dans le cyber-punk, les bonnes fins n'existent pas, on n'est clairement plus au stade de ce genre de considérations...
Conclusion
Résolument complexe, Ghost in the Shell est un film culte. Facile à dire n'est-ce pas ? Culte. Pourquoi ? Tout simplement parce que tout public peut y trouver son compte et que le sujet traité est universel et intemporel. Chacun y décèle des éléments de compréhension ou d'interprétation différent. Le sujet traité est plus que jamais d'actualité (et le sera encore plus dans quelques années). Culte signifie ici qu'il n'est pas envisageable de passer à côté de ce film, qui est l'illustre représentant de son genre.
La dose action/réflexion est de surcroît parfaite. L'animation a bien vieilli et l'ambiance est toujours aussi efficace.
Le mieux, c'est que l'on a l'impression que Ghost in the Shell a réussi là où d'autres échouent : Oshii et son studio distillent ce qu'il faut de nouvelles technologies, ce qu'il faut d'interrogations et restent toujours concentrés sur leur sujet tout en multipliant les voies de compréhension possibles. Trop de films tendant vers le cyberpunk s'égarent aujourd'hui, il n'y a pas cette rigueur dans le traitement du sujet. Ghost in the Shell est LE film sur les rapports de l'Homme avec la machine, sur les délimitations entre eux, sur les problèmes engendrés par une confusion. Trop de films s'égarent en voulant trop en faire et en cherchant à traiter encore davantage de problématiques alors qu'une seule ne trouve même pas réponse... C'est bien pour cela que par tant d'efficacité et d'ouverture, Ghost in the Shell demeure un des meilleurs films qu'il m'ait été donné de voir. Ceux qui prétendent n'y voir qu' un film pompeux et prétentieux de par son trip métaphysique n'ont décidément rien compris.
Fabuleux.
Innocence, Ghost in the Shell 2
Scénario
Là où le premier volet s'axait sur la frontière entre l'Homme et la machine, et où les interrogations du cyborg (mi-humain, mi-machine), tenait une grande place, Innocence renverse les présomptions. Alors que l'on suivait les relations entre Hommes et cyborgs dans le premier volet, on s'intéresse désormais aux relations entre l'Homme/cyborg et la poupée, ainsi qu'entre l'Homme/cyborg et l'androïde (machine seulement d'apparence humaine). Toutefois, si la ligne scénaristique de Ghost in the Shell tenait sans conteste la route, celle d'Innocence est plus que floue.
Alors que les notions posées par le premier volet demeuraient compréhensibles mais très complexes si on poussait un peu, celles de Innocence ne sont pas énoncées. Oshii semble avoir été très inspiré par les androïdes et surtout les poupées (voir la scène finale) mais ne rend pas les choses faciles... Dans Innocence, on retrouve donc Batô et Togusa, de la section 9, chargés de résoudre une affaire de meurtres commis par des androïdes.
Ambiance
Graphiquement, forcément, ça pète. Le carnaval dans Neo-Tokyo brûle l'écran (des confettis, du orange, du jaune, du marron-rouge, tout cela en 3D). Pourtant, on peut regretter que la transition entre 2D lambda et 3D (images de synthèse) soit aussi perceptible. Un travail a été fait sur l'image puisqu'on passe de ruelles ou d'intérieurs sombres à des extérieurs lumineux. D'ailleurs, Oshii perd sa mauvaise manie d'un usage abusif de la couleur ocre, qui faisait que l'on ne sentait que la lourdeur du soleil et les murs suintant dans Ghost in the Shell ou Jin-Roh.
Problème : côté action, c'est quasiment le néant. Deux séquences méritent véritablement l'attention. Vous me direz, il n'y en avait guère plus dans le premier... C'est vrai, sauf que dans le premier volet, on en avait pour son argent, alors que les scènes d'action d'Innocence sont bien trop courtes. Le reste du film est lent sans être attentiste puisqu'on avance dans la solution de l'affaire de meurtres. Mais il est dommage de constater que l'équilibre gunfights/réflexion parfait dans Ghost 1 est ici perdu. Mais tout n'est pas à jeter : il y a beaucoup plus d'angoisse dans Innocence qu'auparavant. Les androïdes et les cyborgs n'ont jamais paru aussi hostiles et inquiétants, aussi froids que leur texture, tandis que le sang fait souvent des apparitions remarquées. Enfin, les dialogues sont peu nombreux entre Batô et Togusa, alors que même Kusanagi était plus bavarde...
La musique est toujours aussi inquiétante. L'ambiance sonore est vraiment parfaite.
Niveau doublage, on reprend les mêmes 10 ans après, la VF demeure soignée.
Trip métaphysique de nouveau ? Pas tout à fait
Batô et Togusa recherchent des indices liés à des meurtres, commis par des androïdes, et se penchent vers un coupable à l'identité physique indéterminée. De plus, la notion de groupement, de personne morale, à travers la société Locus Solus, est introduite, alors qu'on se contentait de la complexité liée à des personnes physiques (humains ou cyborgs) dans le premier opus.
Sur quoi porter sa réflexion dans Innocence, lorsque l'on ne nous guide pas ? Et bien le spectateur cherche... Mais aucun indice de compréhension ne lui sera fourni et sa réflexion sur l'Homme et la poupée ne sera pas non plus alimentée. Dommage...
Restent Batô et son chien, qui prouve qu'Oshii veut introduire le grand absent du précédent volet : l'animal non-humain (je rappelle, il n'est jamais inutile de le signaler lorsque l'on entend ou lit certains individus, que l'Homme demeure un animal malgré ses capacités cognitives importantes...).
Innocence va beaucoup plus loin que son aîné dans les références : Batô passe son temps à citer des auteurs, et ce, toujours à propos. Pas une seule phrase ne s'écarte du contexte, si bien que ce seul personnage rend le film intéressant en nous donnant manière à réfléchir, à défaut de ligne directrice. Heureusement donc que les dialogues sont excellents. Une interrogation ? Paf, une citation. Innocence ne joue pas dans le côté « classe, je cite un philosophe, t'as vu ? », il s'avère juste complexe et revêt l'aspect d'un « film pour intellos »(c'est pas de moi...). Faire avancer un film à grands coups de citations est une performance rarement égalée. Innocence vaut donc le détour pour son schéma narratif particulier et osé.
La rencontre avec un ancien personnage est attendue durant tout le film donc assez prévisible sur la fin... Heureusement, Innocence continue de surprendre pendant et après cette rencontre.
Conclusion
Notez que la jaquette de l'édition simple ne rend guère hommage au film (Batô armé d'un gun au côté d'une androïde). Les bonus de cette édition ne sont pas non plus transcendants. Préférez l'édition collector qui représente réellement le film (une androïde, un chien basset), de meilleurs bonus.

Au final, on a vraiment l'impression qu'Innocence voulait aller encore plus loin en enrichissant le thème vu dans Ghost in the Shell en introduisant :
1. Les relations entre Hommes et androïdes, soit les maîtres et leurs esclaves de plastique et métal
2. La place de l'animal dans ce monde robotisé
3. La notion de personnalité morale à travers une entreprise
Mais ces thèmes ne sont pas assez bien mis en valeur si bien que le spectateur se demande sur quoi il doit porter sa réflexion... En l'absence de guide et de scènes d'action dantesques, l'impression de se retrouver orphelin est palpable, l'ennui s'installe. Cette déception passée, je pense quand même que cet opus n'est pas inutile. Sévère, je peux affirmer qu'il est imparfait. Naïf, je me résous à dire qu'il est mystérieux. Dans les deux cas, on ne peut décemment séparer ce second volet du premier... L'ambiance sonore reste magistrale, la pertinence des réflexions de Batô est un tour de force.
Un film à voir, peu après le premier.
Deux films indispensables. La clef de compréhension du danger que représentent la contemplation et le désir de l'Homme pour la machine.